"Heureuse ?... J'ai peur d'être heureuse", a répondu une femme palestinienne de Gaza lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'elle ressentait après l'annonce du cessez-le-feu.
Elle n'a pas dit qu'elle était "en paix", ni qu'elle était "en sécurité"... elle a dit qu'elle avait peur.
Une phrase courte, mais qui résume la tragédie d'un peuple qui a appris à craindre même l'espoir.
La femme de Gaza ne craint pas la joie parce qu'elle l'ignore, mais parce qu'elle sait très bien que la joie à Gaza ne dure pas plus qu'une trêve.
Chaque silence là-bas est craint comme une introduction à une nouvelle explosion, et chaque aube se lève comme une promesse vague de survie pour un jour de plus.
C'est l'héritage de longs mois de bombardements et de destruction : une peur qu'aucune déclaration internationale n'éteint, ni aucun titre optimiste dans les nouvelles ne dissipe.
En même temps, les nouvelles des palais des politiciens suscitent à la fois étonnement et moquerie.
Benjamin Netanyahu propose Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, "pour son rôle dans la médiation visant à arrêter le massacre".
Oui, dans le même conflit qui a fait des milliers de morts, détruit des hôpitaux et laissé une génération d'enfants qui ne connaissent que les bruits des explosions.
C'est une scène absurde de récompenser celui qui a été complice de l'allumage de la guerre par un prix qui lui est décerné sous prétexte qu'il l'a éteinte.
C'est comme offrir un prix médical à celui qui a arrêté un saignement qu'il a lui-même causé, délibérément et avec préméditation.
"Peur d'être heureuse"... une phrase qui résume ce que le terme "cessez-le-feu" ne dit pas.
La mort peut se calmer, mais la peur reste éveillée, comme une blessure qui ne guérit pas.
Alors que les politiciens se précipitent pour partager la gloire, la vraie question est oubliée :
Quelle gloire est-ce, au-dessus des décombres des maisons, au-dessus des corps des innocents, au-dessus de la douleur des mères ?
Peut-être que le vrai prix est que les enfants de Gaza vivent sans peur de la joie,
Qu'une mère sourit sans craindre que son sourire soit suivi d'une sirène d'alerte,
Que la paix devienne une habitude quotidienne, pas une annonce temporaire.
Ceux qui méritent vraiment le Nobel sont ceux qui n'ont pas quitté les champs de la douleur.
Les mères qui fouillent les décombres de leurs propres mains à la recherche de leurs enfants,
Les médecins qui ont pratiqué des opérations à la lumière des téléphones,
Les journalistes qui ont diffusé la vérité alors que les bombes tombaient sur leurs têtes.
Ils n'ont pas de bureaux luxueux ni de conseillers en communication,
Mais ils ont quelque chose de plus noble : la foi en la vie au milieu de la mort.
Pourtant, leurs voix ne sont pas entendues dans les comités de nomination, ni enregistrées dans les procès-verbaux des conférences,
Car le prix Nobel est décerné là où le bruit est le plus fort, pas là où la douleur est la plus vraie.
Le monde applaudit la "trêve" et oublie que sous elle battent les corps des victimes, et la justice elle-même.
Ils échangent des félicitations, signent des déclarations.
Mais Gaza reste un cimetière à ciel ouvert.
Et au cœur de cette scène, une femme palestinienne dit d'une voix tremblante :
"J'ai peur d'être heureuse."
Peut-être que c'est la phrase qui mérite d'être gravée sur la médaille Nobel de cette année, et des années à venir.
Parce que sur la scène politique, les scènes de paix sont jouées sur la scène,
Tandis que la vraie douleur se vit derrière le rideau, parmi les décombres,
Où la peur de la joie est la dernière chose qui reste de la vie.



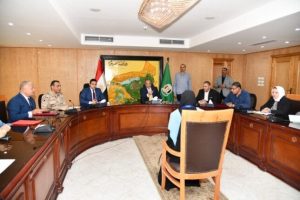









Recommended for you
مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي
طالب الرفاعى يؤرخ لتراث الفن الكويتى فى "دوخى.. تقاسيم الصَبا"
تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء و640 طالبا سيتم قبولهم في الطب
البريد المصري: لدينا أكثر من 10 ملايين عميل في حساب التوفير.. ونوفر عوائد يومية وشهرية وسنوية
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين
الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي