La Première ministre italienne Giorgia Meloni (AFP)
La Première ministre italienne Giorgia Meloni n'a pas été la seule victime de fuites de photos sexuelles sur des sites web ; des dizaines de Tunisiennes ont également été victimes de fuites similaires sur des groupes de l'application Telegram, déclenchant un large débat sur le phénomène de la violence numérique qui touche davantage les femmes que les autres groupes.
Des dizaines de victimes
Comme Meloni, dont des photos intimes ont été divulguées sur un site connu pour publier ce type de photos via le deepfake, des dizaines de Tunisiennes de différents âges ont été victimes de fuites sur des groupes de discussion sur la plateforme Telegram.
Ces fuites sont survenues en réponse à la création d'un groupe Facebook, prétendument géré par des filles, dédié à permettre aux membres de partager des expériences émotionnelles vécues.
Sur les groupes Telegram, des photos très privées de Tunisiennes au visage découvert ont été publiées, souvent avec leurs noms et adresses. Ces photos ont été partagées par des personnes utilisant des pseudonymes ou des identités anonymes, provoquant une large colère parmi les cercles féministes et populaires qui ont demandé aux autorités d'agir pour fermer ces groupes.
En examinant les photos et vidéos publiées, il apparaît que certaines ont été copiées à partir des comptes des victimes sur les réseaux sociaux, avec des modifications évidentes utilisant des techniques d'intelligence artificielle, tandis que d'autres ont été prises à leur insu lors de moments intimes ou envoyées à des personnes avec lesquelles elles avaient des relations antérieures, qui les ont ensuite republiées sans leur permission, à des fins de diffamation et de vengeance.
"Épidémie" de violence en ligne
Cet incident a remis au premier plan le débat sur la violence en ligne contre les femmes, qui prend plusieurs formes : extorsion, vengeance, deepfake ou diffamation, selon l'activiste féministe Rim Al-Haddadi, qui a déclaré à "An-Nahar" : "Afficher des photos de femmes sans leur consentement et les diffamer est une forme de violence numérique."
Une étude menée par le Centre de recherche, d'études, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF), visant à définir la violence numérique et à sensibiliser les victimes femmes et filles pour briser le silence, en prenant Facebook comme modèle, a révélé que 89 % des Tunisiennes ont été victimes de violence numérique au moins une fois sur les réseaux sociaux.
L'étude a également montré que 95 % de ces femmes ne portent pas plainte, soit par peur des menaces et du regard de la société, soit par ignorance du concept de violence numérique et de sa gravité, ou du manque de lois dissuasives.
Dans une déclaration précédente à "An-Nahar", Raja Dahmani, présidente de l'Association des femmes démocrates, a déclaré que l'espace numérique n'est plus sûr pour les femmes, comparant la violence numérique à "une épidémie silencieuse qui menace la dignité des femmes."
Elle a également confirmé que plus de 45 % des femmes ont été exposées à une forme de violence numérique, que ce soit par des menaces, de la diffamation, du piratage ou du chantage.
La loi tunisienne la criminalise
Sur le plan juridique, la Tunisie a traité ces phénomènes et les a classés comme des crimes relevant de la violation de la loi sur la protection des données personnelles, et de l'article 86 du Code des télécommunications relatif à la publication de contenus portant atteinte à autrui sur les réseaux sociaux.
Ces actes relèvent également du décret 54, qui a renforcé les sanctions pénales pour ceux qui publient délibérément du contenu dans le but de diffamer, calomnier, nuire à la réputation, causer des dommages matériels ou moraux, inciter à l'agression d'autrui ou encourager les discours de haine.
Selon les textes juridiques tunisiens, la peine pour ces crimes peut aller jusqu'à 5 ans de prison, en plus d'amendes, même si les photos sont publiées dans des groupes fermés.
Cependant, malgré l'existence de textes légaux permettant aux victimes de poursuivre ceux qui leur nuisent sur les réseaux sociaux, la peur de la société reste le principal obstacle empêchant la majorité d'entre elles de se tourner vers la justice, selon Al-Haddadi, qui estime que cela "contribue à l'impunité, ce qui pourrait conduire à l'aggravation de ces phénomènes."




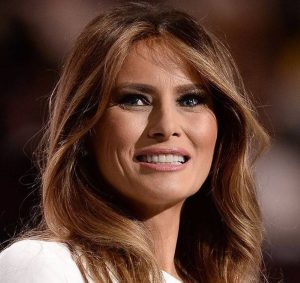






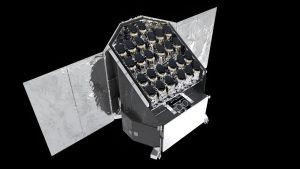


Recommended for you
طالب الرفاعى يؤرخ لتراث الفن الكويتى فى "دوخى.. تقاسيم الصَبا"
مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي
تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء و640 طالبا سيتم قبولهم في الطب
البريد المصري: لدينا أكثر من 10 ملايين عميل في حساب التوفير.. ونوفر عوائد يومية وشهرية وسنوية
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين
الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي